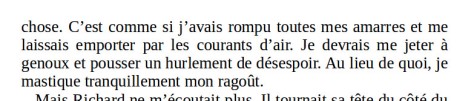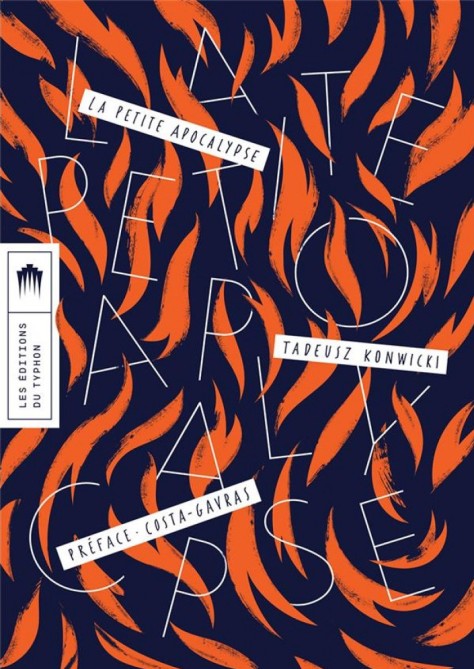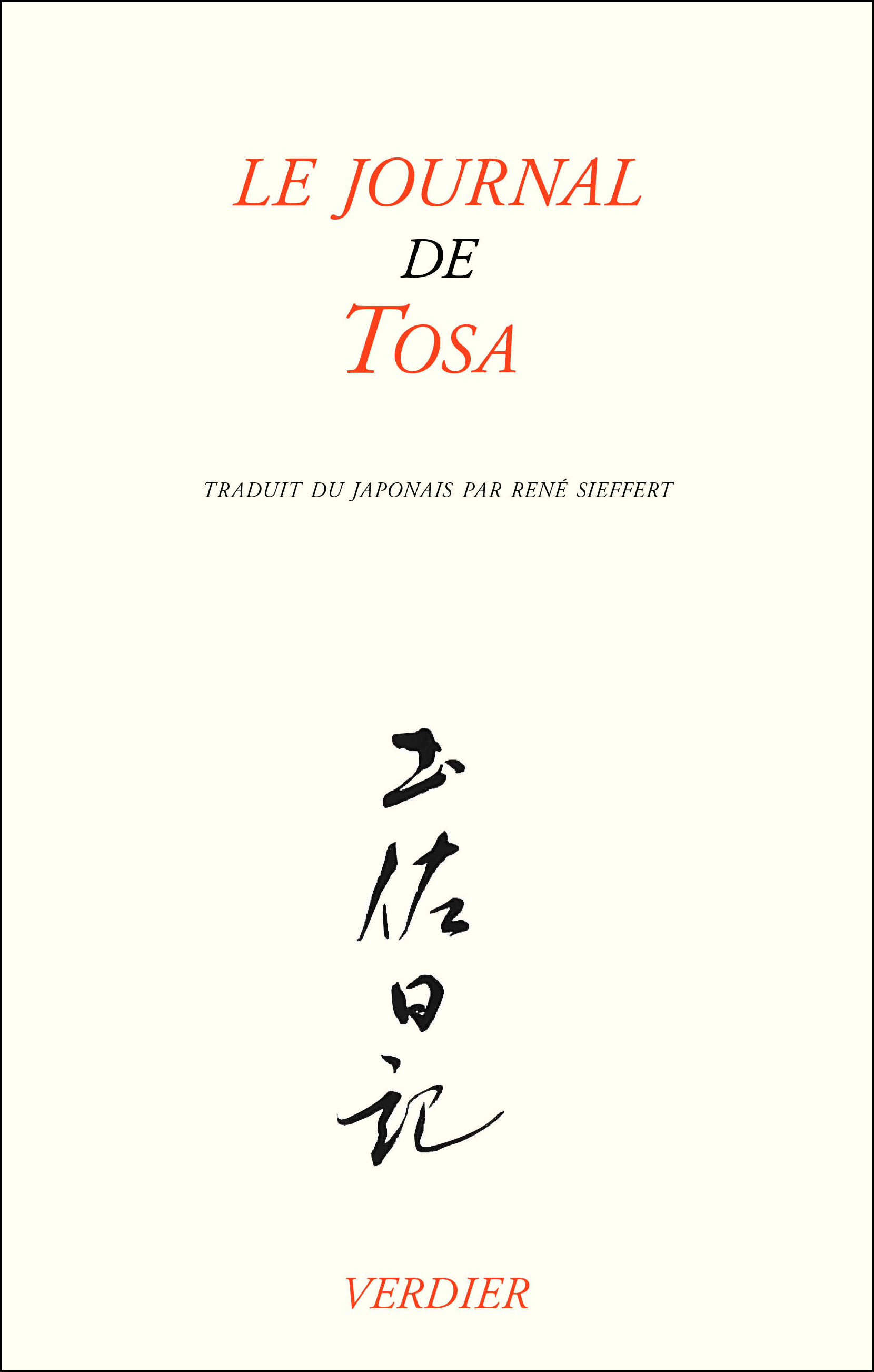Un loquet à pousser – Théo – Crème pâtissière – Retour sur la matinée – Le puissant sorcier Tours-de-Bassin
“Tu sens ce parfum derrière ? De la rose non ?”
La première fois je monte par l’ascenseur, à la suite de l’hôtelier. C’est un vieux bâtiment. La chambre qu’il me montre est au 7ème. Ça s’appelle Golshan Hotel et c’est 400 000 rials la nuit, un prix inespéré malgré la crise. Un lit, un petit bureau, une table de chevet. Une moquette sombre peut-être. Par la fenêtre grillagée de moustiquaire (et de barreaux ?) je reconnais les hauteurs de la masjid-e kabud et les arètes du musée archéologique. Le soleil déjà baisse.
Je me défais de mon sac à dos. (Il se pose sur la moquette.)
Il s’agit d’un acte de tendresse.
Ça fait longtemps que je ne me “débarrasse” plus de mon sac comme dans un couloir de collège. C’est pas une histoire de fragilité. Avec Mélody on s’est longtemps, fidèlement, tenu informés de nos déboires de paquetage : elle, retrouvait régulièrement sa bouteille de shampoing éclatée au fond du sac. Moi au Sahara je cassais des écrans d’ordinateur. Maintenant je me rends compte du soin avec lequel je manipule mon sac à dos. Dans les bus, sur les falaises, je l’enlace. On regarde le paysage côte à côte, on y reprend notre souffle. Et même s’il y a un tapis ou une moquette, comme il semble que ce soit le cas dans cette chambre d’hôtel iranienne, je me contracte un peu en le posant à terre, et cette contraction ne s’explique que par la tendresse que je conçois à son égard.
Par ailleurs, ceci est une réflexion au fil de la plume. La plume a six mois de retard sur les nerfs. Ce n’est pas de l’Iran brut.
L’Iran brut c’est l’Iran de mes nerfs :
j’ai posé mon sac sur la moquette, je me sens léger, mettons que je réponds quelques mots à l’hôtelier pour qu’il s’en aille. Pour affranchir la pièce de sa présence. Pour être un seul corps, contenu dans une seule pièce. L’hôtelier est gentil, je dévalerai très bientôt les escaliers lui apporter mon passeport et mes rials. J’ai juste besoin de refermer la porte derrière lui, de me retourner, de voir cette pièce vide à ma seule exception. C’est chez moi. Cette chambre du 7ème étage. L’opération est faite. La moquette sombre (disons), le lit simple, le petit bureau auquel je m’assoirai peut-être jamais mais qui pose cette atmosphère fruste et studieuse dont je lui suis gré. À cet instant c’est l’endroit dans lequel il est permis que je me déverse. Mon corps pourrait bien céder. C’est grandiloquent à dire. Un nouveau contenant vient de m’être alloué : ces murs, cette moquette et ce grillage au-delà duquel se grise la vie tabrizie, ils sont un peu comme une peau, comme des vêtements, à l’intérieur c’est moi : inaccessible. Inafuckingccessible. Et l’excitation monte à l’idée d’avoir un loquet à pousser, et une pièce à considérer de l’intérieur, seul. Je pourrai m’assoir en boule en plein milieu de la pièce. Je pourrai manger en caleçon devant la fenêtre, ou sans caleçon. Tout est à ma portée. Autour de moi les regards sont éteints. 400 000 rials et je mouche l’éclat de tous les yeux.
Il y a une salle de bains sur le palier. Je ne pense pas m’en servir. Hier j’ai eu droit à dix rasoirs et à deux serviettes, à du carrelage, à du propre. J’ai bien sué aujourd’hui mais je suis pas à cheval sur la sueur. Et je sens que je peux rester ici, des jours. “Des jours” ça se dit avec surprise et délectation, avec la conscience de parler de choses qui nous dépassent. Dans la bouche d’un petit routard en tout cas ça se vit (et se dit) comme ça. On dit “des jours”, avec emphase, c’est presque madame Verdurin qui parle. ‘For daaays!’ S’autoriser à se fendre des 400 000 rials quotidiens (environ 3 € au taux gracieux du marché noir). Se faire une gâterie. Se choyer.
Je pense à Hélène Bessette en écrivant ces phrases, en m’observant ce style. Je l’ai lue quatre mois après Tabriz : La Tour, chez Léo Scheer. Et ceci n’est pas de l’Iran brut.
“C’est hyper jaune, tu crois qu’ils utilisent du safran ?”
Théo est là.
C’est-à-dire : je descends payer la nuit et déposer mon passeport à la réception. Je leur demande s’il y a un cyber dans le coin. L’homme répond que l’hôtel a le wifi. J’aurais pas parié. Retour à la chambre, je tape le mot de passe qu’il m’a dit. C’est vrai. Au 7ème aussi. C’est peut-être à ce moment-là que je me mets à penser : “Des jours !” Avec le bureau c’est même une chambre pour écrire, indiscutablement. Pour entrer dans un personnage d’écrivain. Et c’est aussi à ce moment que je reçois des nouvelles de Théo. Il est donc là. Il est à Tabriz.
Ce n’est pas brut mais : cinq mois plus tôt je quitte la Bosnie par le col au-delà de Trebinje, journée de stop très ensoleillée, boulevards de Podgorica, frontière albanaise à la nuit tombée, je stoppe sur Shkodër en recopiant à la va-vite pershendetje (bonjour) et faleminderit (merci), dans mon carnet figure aussi un nom d’auberge : The Wanderers. Aujourd’hui le coeur pince à retrouver ces mots-là dans ma mémoire, et il me tarde de retourner baragouiner albanais. Shkodër. Dans mon dortoir je parle au type qui, en face de mon lit, assis sur le sien, farfouille dans son gros sac à dos. Je dirais qu’il a un teeshirt bleu. C’est Théo. Lui est passé par Gênes et les Pouilles, avec l’aide d’un routier bulgare. Un mois plus tard, je le retrouve devant la vieille mosquée de basalte de Diyarbakır. Quelques jours avant l’Iran, il vient passer une journée à Erevan, le jus des herbes hachées menu de nos djingialov hats coule sur nos poignets dans le petit restaurant de l’avenue Teryan (ou on a trouvé porte close ? Non je crois qu’on a déjeuné là-bas, et bu de l’ajran), on mange une glace, on va dans les rues et les parcs, sur les promenades, puis il part, le lendemain, vers le sud et vers l’Iran aussi. Peut-être qu’il a pris le temps d’aller au monastère au-delà de Jolfa. Je pense qu’il est moins flemmard que moi, que les monastères ça compte encore, pour lui, et les oiseaux aussi, il y avait une histoire d’oiseaux par là-bas, ornithologique, si je me souviens bien.
Et Théo est donc ici, à Tabriz, aujourd’hui, et il vient dans mon quartier ce soir.
“Tu vois, j’ai googlé bastani sonnati, ils mettent du jaune d’oeuf, c’est ça cette épaisseur, ce…”
Entre le musée et la masjid-e kabud, la vieille mosquée bleue (timouride me dira Sylvie), s’étale un square tranquille. À l’entrée je cueille Théo. Je veux l’emmener manger une glace, celle que m’a payée hier le mec qui m’a hébergé, le costumé de Shah Goli, l’homme de Valiasr (peu importe la nomenclature, et son prénom j’ai oublié). Cette glace était une expérience inoubliable. Je me rengorge de cette ébauche de distanciation. Le grain de l’ivraie. Le grain : les prunes au miel, la salle de bains propre et (miracle) le glacier près de Shahid Beheshti. Le cornet coute 30 000 rials. C’est que dalle pour une expérience de cette nature. Et depuis Diyarbakır, retrouver Théo est aussi devenu l’occasion de se jeter sur les premières glaces venues.
“Ce gout vraiment ample, de… de vanille ?
– Un peu différent…
– De crème pâtissière ! De crème pâtissière !”
On lèche notre glace assis sur le banc devant la boutique. Le glacier nous lance des coups d’oeil par la vitrine. Parfois une voiture se range près du trottoir et un homme en sort, pour commander des faloudehs ou des bastanis, tandis que la petite famille se préserve au souffle de la clim.
Je finis par raconter à Théo la journée d’hier. Le parc, le type en costume, les courses démesurées au bazar, les rasoirs, Valiasr, les bonnes prunes au miel, et aussi qu’à 2h du matin des bruits m’ont réveillé, c’était la télé, le mec regardait du porno, le mec faisait dormir un garçon dans son salon et laissait la télé au-dessus du lit diffuser du porno gay à 2 h du matin, sans couper le son. Pendant une demi-heure, sur mon matelas trop chaud, j’ai navigué sur des sentiments de dégout et d’anxiété. Allait-il se souvenir de ma présence ? S’approcher ? J’ai fini par l’entendre qui ronflait. Alors la peur est partie, j’ai eu de la haine seulement, en me rendormant, et le matin aussi, au petit-déjeuner, le dégout balayait les convenances, je redemandais de tout, du yaourt, des dattes, je voulais liquider son affaire, j’aurais pu le voler. L’éducation ne m’inhibait plus. Oui je reveux du thé, des dattes, du dough, et maintenant on file dans le centre (tu paieras pour moi le bus), j’ai envie qu’on y aille maintenant, et je prends mes affaires, oui maintenant, oui j’emporte les dix rasoirs, et malgré tout ça j’arriverai jamais à la cheville de ton impolitesse.
On a traversé une partie du bazar à nouveau. Je voulais changer de l’argent mais je renâclais. Ce que je voulais, c’était me débarrasser de lui. Tout faire sans lui. On est parvenu à la masjid-e kabud. Il m’a dit “Je t’offre l’entrée, il n’y a pas de problème”, j’ai dit non, peut-être qu’un jour je paierai l’entrée, là je voulais juste être libre, seul, je voulais plus rien partager avec ce type, même pas ce morceau de trottoir (quelques bancs, un kiosque à journaux et des visiteurs iraniens qui m’observaient avec bienveillance), ni des paroles, encore moins 100 mètres de plus.
Il est resté très stoïque au moment où je lui ai faussé compagnie, je l’ai senti barricadé dans ses propres inhibitions, la gueule encore plus longue et fermée qu’avant, inadaptée. Je vois bien qu’il a des problèmes. Je peux pas les résoudre. C’est trop tard, y a trop de vase qui s’est déposée, mon problème à moi c’est de me débarrasser de lui, je lui tourne le dos et commence à remonter l’avenue, je sais où changer de l’argent, je ferai ça tout seul, et trouver un cyber, un hôtel.
“C’est ça, c’est tout à fait ça, de crème pâtissière !
– C’est diiingue.”
Changer mon fric à Tabriz. C’est sur un carrefour bruyant, qui ouvre sur les venelles couvertes du bazar, et surplombé d’une belle banque dans laquelle on entre pas. Le change, on le fait sur le trottoir, y a des guichets bardés de panneaux affichant les taux, et plein de mecs qui offrent les leurs. Je déambule un peu, sans regarder personne. Un type m’interpelle, il est sur la chaussée, il bavarde ou fume. Je finis par le reconnaitre : c’est l’un des vieux d’hier ! L’un des vieux (numérotés 6° dans la liste) qui faisaient des tours de bassin à Shah Goli. Là, soudain. C’est le retour de la bienveillance. On échange quelques phrases, comme les dernières fois il cultive une douce réserve. J’ai l’impression que la pellicule a sauté. Que j’aurais pu ne pas passer la nuit à Valiasr, qu’un de mes avatars a connu une autre expérience. Dans un passé alternatif c’est lui, Tours-de-Bassin, qui m’a invité : j’ai dormi dans une chambre proprette d’un sommeil de plomb, dans un autre quartier, et après m’avoir montré quelques lieux emblématiques du vieux bazar nous nous disons au revoir ici. Pour quelque raison obscure, l’homme de Valiasr a aspiré cette version-là de ma première nuit à Tabriz. Dans une distorsion mythologique il a combattu en duel et défait le doux vieux Tours-de-Bassin au sommet des monts rouges qui dominent la ville (au couchant embrasés, saignants, tandoori ; on les a vus dans le bus hier, ce rouge rôti écrasant la masse beige et grise de Tabriz, et je m’étais dit : “La ville la plus hideuse au monde serait rachetée par une montagne comme ça »). Ou alors le doux vieux Tours-de-Bassin a bien plus de pouvoirs qu’on ne le croit : il a jeté à bas l’homme-de-Valiasr qui, en pleine chute, dans un dernier sortilège a dénoué sa cravate et l’a entortillée autour de sa cheville, vainqueur et vaincu projetés ensemble dans le vide. Toute la nuit Tours-de-Bassin et l’homme-de-Valiasr ont combattu dans l’air glacé des limbes de la montagne rouge. Se disputant le petit routard européen égaré dans un futur de l’homme-de-Valiasr. Tours-de-Bassin me sauvant la mise sur le sofa puis sous la télé. Jusqu’à ce qu’enfin il triomphe, me détachant pour de bon de l’emprise de l’ennemi, me libère dans les rues plombées de soleil et en guise d’épilogue m’envoie le croiser 500 mètres plus loin.
“Je sais pas combien de temps je reste à Tabriz mais je compte venir ici tous les soirs. Ça me rappelle les chouquettes garnies, tu sais… À la boulangerie à Nouméa on les garnissait à la crème diplomate…
– Oh, la crème diplomate…”
Je raconte à Théo toute l’expérience Valiasr. J’imagine qu’aujourd’hui il ne s’en souvient plus. Chacun son Iran brut. On commente encore le maléfice gustatif, l’exténuante douceur de nos glaces. Il fait nuit, Théo dort dans un petit parc, à trois quarts d’heure à pied de Shahid Beheshti. Je l’y rejoins peut-être demain? J’hésite encore, trop heureux de disposer de cette petite chambre à fenêtre grillagée. Maintenant je marche vers l’hôtel. Une voiture sort d’un parking. Une vitre est baissée, une main me tend un sandwich. ‘Where are you from? Welcome to Iran!‘ 200 mètres puis 7 étages passent. Sur mon ordinateur c’est toujours la page de mes mails. Il y en a un nouveau. C’est des éditeurs, ils voudraient me parler d’un texte que je leur ai envoyé. Je fais quelques pas vers la fenêtre, mes yeux percent le grillage et passent dans la nuit. J’ai un long sourire aux lèvres. Je fais un ou deux tours dans la petite pièce, mon cerveau tourne à vide. Je reviens à la fenêtre, je dois faire quelque chose de mes bras, ils veulent s’exprimer, ça déborde, j’ai que le mail en tête, je me sens idiot et heureux, je pose les mains derrière la nuque, je regarde à la fenêtre.